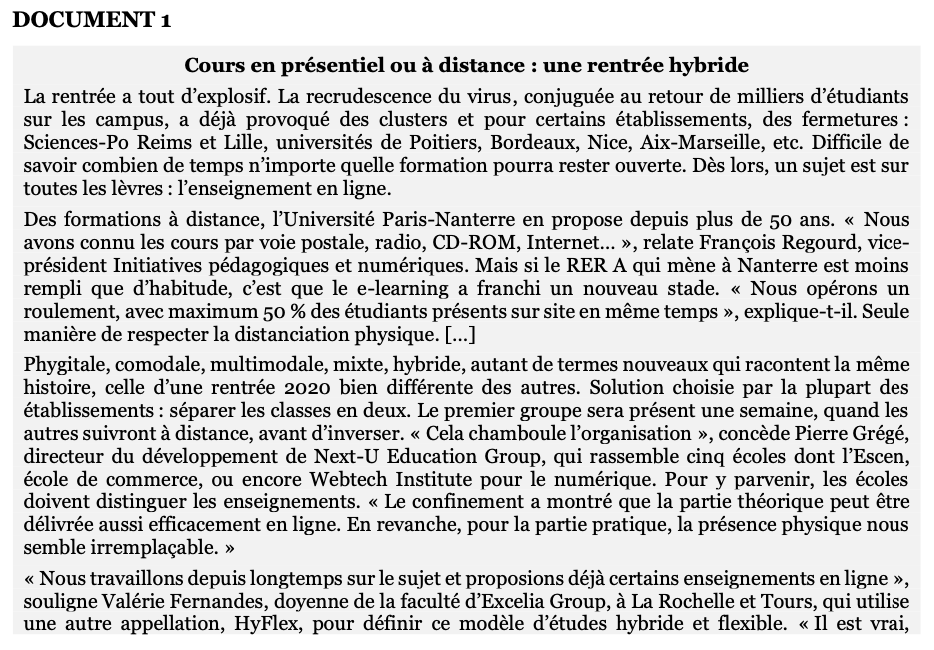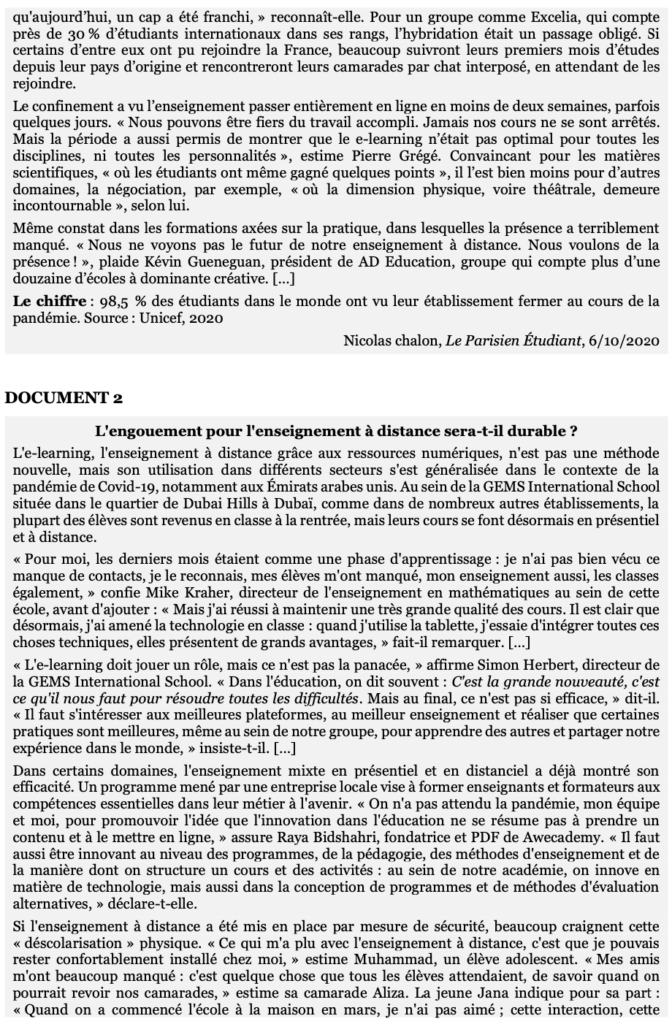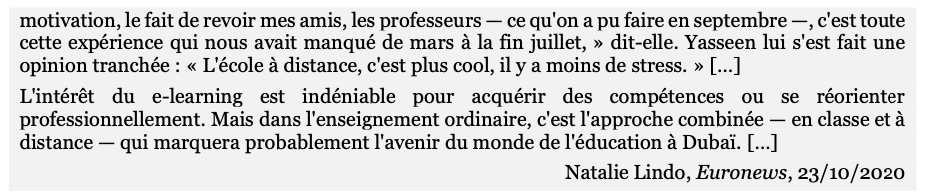Épreuve n°1 : Synthèse de documents
Vous ferez une synthèse des documents proposés, en 220 mots environ (+/- 20 mots). Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu’ils contiennent, vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents, et vous les présenterez avec vos propres mots, sous forme d’un nouveau texte suivi et cohérent.
Attention :
– vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre, et non mettre deux résumés bout à bout ;
– vous ne devez pas introduire d’autres idées ou informations que celles qui se trouvent dans les documents, ni faire de commentaires personnels ;
– vous pouvez bien entendu réutiliser les mots-clés des documents, mais non des phrases ou des passages entiers ;
– le respect de la consigne de longueur fait partie intégrante de l’exercice.
Dans le cas de non respect, on appliquera une correction négative : 1 point de moins par tranche de 20 mots en plus ou en moins.
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placés entre deux espaces. «c’est-à-dire » = 1 mot; «un bon sujet
Épreuve n°2 : Essai argumenté
Vous avez lu dans un magazine étudiant une pétition contre l’enseignement en ligne à l’université. Vous écrivez au courrier des lecteurs pour réagir à cette critique. Vous essayez de convaincre des atouts d’un modèle hybride, qui alterne cours à distance et cours en classe. 250 mots minimum
Synthèse
Deux articles parus en octobre 2020 dans Le Parisien Étudiant et Eurnoews abordent le thème de l’e-learning. À la lumière de la crise sanitaire et la montée de l’e-learning qu’elle a provoquée, quelle est l’environnement idéal pour l’enseignement ?
La pandémie a obligé la majorité des institutions d’enseignement à adopter une méthodologie d’instruction en distanciel. En effet, de nombreux professeurs soulignent la multitude de bienfaits qui résultent de l’e-learning. En particulier, ce type d’instruction les a forcés à intégrer de nouvelles technologies qui les ont aidés à améliorer leur qualité d’enseignement. De surcroît, il a remis en cause leurs pratiques existantes, les encourageant à éliminer des pratiques inefficaces. De la perspective des étudiants, ils constatent une diminution de stress notable en travaillant à distance.
Nonobstant de tels avantages, des élèves et éducateurs ne sauraient nier la kyrielle de problèmes que l’e-learning a engendrée ces dernières années. À titre d’exemple, l’apprentissage en distanciel ne s’est avéré guère idéale pour certains sujets, surtout ceux qui s’appuient sur l’interaction entre les étudiants tels que la négociation. Par ailleurs, des éducateurs se sont également rendus compte que le contact en présentiel était indispensable pour les élèves afin qu’ils puissent forger des amitiés et développer des compétences sociales.
En tenant compte de l’expérience des élèves à travers le monde pendant le Covid-19, il semble probable que le meilleur style d’enseignement est dorénavant un mode hybride qui intègre des innovations mises en valeur lors de la pandémie, ainsi que des méthodes traditionnelles et éprouvées.
Essai Argumenté
La modèle hybride : l’avenir de l’éducation
À la suite de la publication de la pétition contre l’enseignement en ligne à l’université parue dans votre dernier numéro, je me permets d’écrire au courrier des lecteurs pour exprimer mon profond désaccord. En effet, plutôt que d’abandonner ces méthodes de l’ère pandémique, je suis convaincu que nous devrions redoubler nos efforts et à la fois mettre en œuvre et mettre au point ces outils indispensables, pourtant, dans le cadre d’un modèle d’enseignement hybride.
Tout d’abord, a contrario des opinions exprimées dans votre numéro, il va de soi que certains avantages de l’enseignement se sont avérés indéniables ces dernières années. En particulier, je ferais référence aux nouveaux types d’apprentissage et l’augmentation de l’accès à l’éducation grâce à l’e-learning. À mon université, Sciences Po, nous pouvions offrir nos cours aux étudiants à travers le monde pour la première fois. Dans ma classe, des étudiants pakistanais, taïwanais, brésiliens, entre autres nationalités pouvaient rejoindre et apprendre de certains des meilleurs professeurs en France. De surcroît, nos étudiants français bénéficiaient de cette plus grande diversité d’idées, de cultures, et de points de vue en classe.
Dans la même veine l’enseignement en distanciel a facilité bien des programmes à l’étranger pour nos étudiants, leur permettant par exemple d’étudier les politiques d’Amérique latine en habitant au Mexique, tout en suivant leurs cours avec nos professeurs à distance. J’aimerais vous désabuser de cette idée que l’apprentissage en distanciel soit moins efficace. Bien au contraire, de nombreuses études ont en fait révélé que les étudiants apprenaient mieux certains sujets dans un environnement virtuel !
Néanmoins, je compatis avec mes camarades mécontents. L’enseignement en distanciel peut engendrer de nombreux inconvénients. Beaucoup d’élèves déclarent qu’ils le trouvent difficile de forger et entretenir les amitiés dans le cadre virtuel. Qui plus est, certains peuvent se sentir moins motivés et moins investis dans leurs matériaux et en conséquence ils ont du mal à obtenir de bonnes notes. Finalement, n’oublions pas qu’il peut s’avérer éprouvant de développer notre communauté comme une université ainsi que rencontrer des autres en apprenant à distance.
Cela étant dit, il est clair que nous ne saurions et nous ne devrions pas revenir en arrière et abandonner ces nouvelles pratiques. Ce faisant, nous risquerions de tomber en obsolescence et de perdre du terrain par rapport à nos pairs outre-Manche, outre-Rhin, et outre-Atlantique. Plutôt, nous devrions encourager nos universités à adopter et exploiter les bonnes pratiques et nouvelles technologies que nous avons développées pendant la pandémie pour pouvoir continuer à attirer les meilleurs étudiants du monde en France et renforcer la position de la France comme un chef dans le cadre de l’éducation à travers le monde.
(Nombre de mots en comptant le titre = 447)
Les Textes